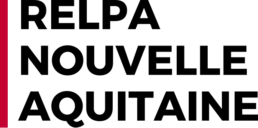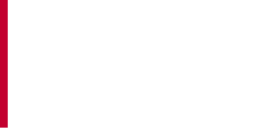Combien de gens faut-il affamer pour désengorger les hôpitaux ?
La stratégie gouvernementale rend invisibles les vies abrégées par la récession de l’économie. Tous les scénarios tueront, plaident les auteurs de la tribune (article signé par un collectif, également publié dans le journal Le point https://www.lepoint.fr/debats/tribune-combien-de-gens-faut-il-affamer-pour-desengorger-les-hopitaux-02-11-2020-2399122_2.php)
Pendant les deux mois du confinement de mars, environ 1,3 million de personnes ont sollicité l’assistance du Secours populaire, dont 45 % étaient jusque-là inconnues de l’association.
« Une précarité jamais vue depuis la Seconde Guerre mondiale. » C’est par ces mots que le Secours populaire commente la situation sociale de la France. L’ONG signale que, pendant les deux mois du confinement de mars, environ 1,3 million de personnes ont sollicité son assistance, dont 45 % étaient jusque-là inconnues de l’association. À titre de comparaison, ils étaient un peu plus de 3 millions sur l’ensemble de l’année 2019.
Ce constat s’ajoute aux 490 millions d’âmes qui, selon l’ONU, pourraient retomber dans une pauvreté multidimensionnelle. On peut ajouter à ce sinistre bilan la perte de chance pour ceux qui, aujourd’hui ou demain, auraient dû sortir de la pauvreté, mais verront leur condition misérable prolongée. Même si cette hécatombe indirecte est, il est vrai, plus difficile à chiffrer.
Cessons de nier notre culpabilité. Ce n’est pas le Covid-19 qui augmente en ce moment même le nombre de misérables dans le monde. Ce sont les mesures sanitaires prises pour ralentir l’épidémie. Il est vrai que la pandémie aurait – quoi qu’il arrive et indépendamment des mesures sanitaires – provoqué une récession de l’économie mondiale. Mais, ainsi que le suggère le bilan de la grippe espagnole, un virus comme celui que nous connaissons n’a pas les capacités de mettre, à lui seul, l’économie mondiale à genoux. Autrement dit, même ralentie par le virus, notre économie n’aurait jamais connu une récession aussi violente sans des mesures sanitaires aussi strictes.
Dans un article paru dans la revue Foreign Affairs, l’historien Walter Scheidel rappelle en effet que la grippe espagnole – en dépit du fait qu’elle a emporté avec elle environ 2 % de l’humanité – n’a pas détruit l’économie mondiale dans les mêmes proportions qu’aujourd’hui : « La production industrielle a fortement baissé, mais a rebondi en quelques mois. […] Selon la dernière analyse économétrique, la pandémie de 1918-1919 a réduit le PIB réel et la consommation des États-Unis de 2 % au maximum. Il semble qu’il en ait été de même pour la plupart des économies occidentales avancées. » Schneidel rappelle que les gouvernements d’hier ont fait preuve de beaucoup plus de souplesse qu’aujourd’hui.
Il est facile d’expliquer la différence de traitement entre les deux pandémies. En 1918, l’espérance de vie globale était bien inférieure à celle de notre époque. L’aversion au risque de mourir d’une maladie était plus faible. Parce que nous conférons aujourd’hui plus de valeur à la vie, nous voulons davantage la protéger. Assurément, c’est un progrès civilisationnel.
On peut toutefois se demander si on protège vraiment la vie en restreignant son libre cours. Depuis le début de cette pandémie s’impose la doctrine plus que douteuse qui voudrait que « la santé prime sur l’économie ». Comme si la richesse d’une société ne conditionnait pas la santé d’une population. Ceux qui expliquent que l’économie n’est qu’une affaire de gros sous devraient le dire aux Libanais, dont les hôpitaux suspendent une partie de leur activité faute de moyens, ou aux Africains dont l’espérance de vie est inférieure de vingt ans à celle de la France en raison d’un insuffisant niveau de développement.
Les thuriféraires de l’ordre sanitaire ou du « monde d’après » oublient en effet que la pauvreté tue aussi. Les données du Global Burden of Disease diffusées par l’Institute for Health Metrics and Evaluation rappellent que 365 millions d’années de vie en bonne santé ont été perdues en 2017 en raison des maladies cardiovasculaires. Selon l’OMS, la majorité de leurs victimes se situe dans les pays émergents et en voie de développement. 58 millions d’années en raison de déficiences nutritionnelles. 62 millions d’années en raison du paludisme et d’autres maladies tropicales. 112 millions d’années en raison de maladies respiratoires. Ces pathologies précèdent le covid et lui succéderont. Une part significative d’entre elles est liée à la pauvreté. Celle-ci rend inaccessible l’accès aux soins, aux subsistances, aux technologies ou au mode de vie qui permettent de les prévenir.
Sur le court, le moyen et le long terme, la pauvreté est donc un facteur de mortalité plus important que le covid-19. Saboter l’économie, c’est gonfler les rangs de ses victimes. C’est aussi infliger une perte de chance en prolongeant les souffrances de ceux qui, en France ou ailleurs, auraient pu s’en délivrer plus tôt si nous n’avions pas provoqué la monstrueuse récession à laquelle nous assistons. Rappelons par exemple qu’en France l’Insee indique que les 5 % les plus riches vivent en moyenne 13 ans de plus que les 5 % les plus pauvres. La corrélation entre richesse et espérance de vie n’est donc pas propre aux pays du tiers-monde.
« Tout châtiment qui n’est pas absolument nécessaire est tyrannique », nous dit Montesquieu. Notre tradition philosophique pose la liberté comme principe et soutient que sa suspension ne vaut que si sa nécessité est démontrée. La charge de la preuve que la liberté pose plus de problèmes que de bénéfices incombe à ses adversaires. C’est pourquoi un magistrat n’incarcère jamais un accusé sans la certitude que sa liberté mérite d’être anéantie.
Nous sommes pourtant en train d’assigner tout un pays à résidence sans la moindre preuve que le remède n’est pas en train de soigner le patient en le tuant. Si le confinement avait été un médicament, les autorités sanitaires ne l’auraient jamais mis sur le marché. En effet, ses partisans admettent que les preuves de son incidence positive sur le bien-être global sont inexistantes et qu’ils agissent au nom du principe de précaution. C’est donc un pari qu’ils font sur nos vies.
Leur précautionnisme est toutefois étriqué. Il ne se préoccupe que des risques de la liberté et ignore les dangers de sa suspension. On est frappé de voir à quel point les partisans du confinement n’ont jamais la voix qui tremble et n’évoquent guère les victimes collatérales de leur arbitrage. Celles-ci sont invisibilisées par le discours sanitaire dominant. Le discours présidentiel a perpétué cette dissimulation. Emmanuel Macron a continué de feindre que son arbitrage n’entraînerait aucun désastre humanitaire, entretenant l’illusion qu’il ne ferait que sauver des vies et rien d’autre. Pas une seule fois a-t-il posé la question de savoir si nous n’étions pas seulement en train d’ajouter une catastrophe artificielle à la calamité naturelle.
On comprend bien sûr les raisons de cette omission volontaire. Les vies abrégées par l’engorgement des hôpitaux le sont d’une manière immédiate, visible et concentrée. À l’inverse, les vies raccourcies par la misère le sont d’une manière plus diffuse dans l’espace et dans le temps. Médiatiquement, les premières auront donc toujours l’avantage sur les secondes. Mais sont-elles plus nombreuses ?
Les Français ont le droit de considérer qu’il faille suspendre l’économie en dépit de notre ignorance sur l’opportunité de cette mesure. Gardons-nous toutefois d’être hypocrites, d’assimiler le fait d’affamer les plus fragiles à de l’humilité, et de nous donner bonne conscience en assénant sur un ton péremptoire que nous faisons œuvre de charité. Il n’en est rien. Parce que nous ne parvenons pas à dompter une catastrophe naturelle, notre complexe démiurgique conduit à nous venger sur la seule chose que la biopolitique nous permet de contrôler : la vie de ceux que nous détruisons délibérément.
Ces mesures que nous acceptons tacitement n’ont qu’un objectif : ménager notre indignation. Il nous serait insupportable de voir les gens mourir d’un virus faute de place à l’hôpital tandis que les indigents qui dépérissent à petit feu par notre acharnement nous sont indifférents. Dans ces conditions, gageons que les adeptes de la République sanitaire de Platon auront toujours la conscience tranquille, à défaut d’avoir une âme vierge de toute culpabilité.